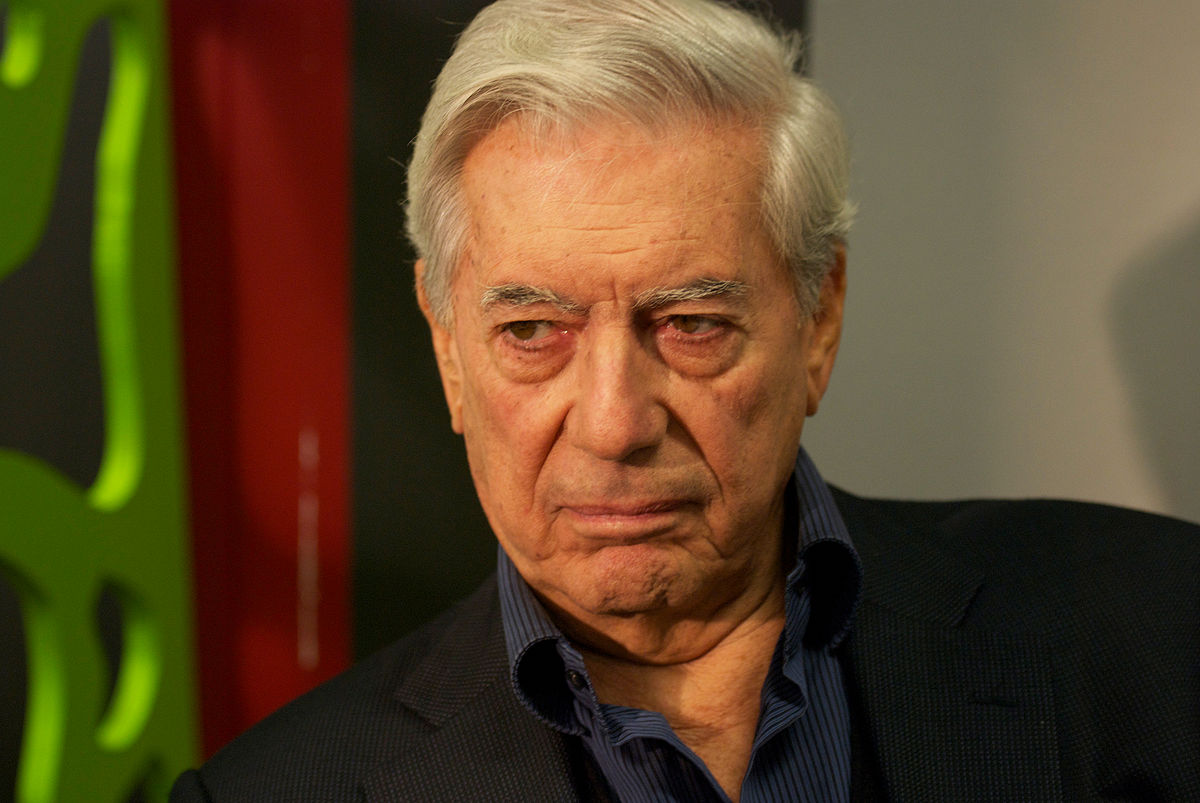 Point
de vue. En Europe et en Amérique latine, assumer son libéralisme est
source de raillerie. L'écrivain Mario Vargas Llosa ose le revendiquer.
Point
de vue. En Europe et en Amérique latine, assumer son libéralisme est
source de raillerie. L'écrivain Mario Vargas Llosa ose le revendiquer.
Afin
d'expliquer ma position politique, je crains qu'il ne suffise pas de
dire que je suis un libéral. Le terme lui-même suscite une première
complication. Selon la personne qui l'utilise et l'endroit où elle le
prononce, le mot « libéral » revêt des significations différentes.
Ma
grand-mère Carmen l'employait pour désigner un homme aux mœurs
dissolues. A ses yeux, le prototype même du « libéral » était cet
ancêtre légendaire de notre famille, qui a annoncé un jour à sa femme
qu'il allait acheter le journal au kiosque voisin, et qui n'est jamais
rentré. La famille n'a entendu reparler de lui que trente ans plus tard,
pour apprendre qu'il venait de mourir à Paris.
« AMANT DE LA LIBERTÉ »
Aux
Etats-Unis, et dans le monde anglo-saxon en général, le mot « libéral »
est connoté à gauche et se trouve parfois associé avec le reproche
d'être un socialiste ou un radical. En revanche, en Amérique latine et
en Espagne, on me qualifie de libéral – ou, pire encore, de néolibéral –
pour me discréditer. La perversion politique de notre sémantique a
transformé la signification originale du mot – « amant de la liberté »,
une personne qui se dresse contre l'oppression – pour en venir à
désigner un conservateur ou un réactionnaire.
En Amérique latine, le libéralisme était une doctrine philosophique et politique progressiste qui, au XIXe siècle,
s'opposait au militarisme et aux dictateurs, et réclamait
l'instauration d'une culture démocratique et civile. Les libéraux furent
persécutés, exilés, emprisonnés ou tués par les régimes brutaux qui, à
de rares exceptions près, prospéraient alors sur l'ensemble du
continent.
Au XXe siècle,
c'est la révolution, non la démocratie, qui fut la principale
aspiration des élites politiques d'avant-garde, une aspiration partagée
par de nombreux jeunes gens qui ont voulu suivre l'exemple de la
guérilla menée par Fidel Castro. Ce n'est que dans les dernières
décennies du XXe siècle
que les choses ont commencé à changer, et que le libéralisme a été
reconnu comme quelque chose qui n'avait à voir ni avec la gauche
marxiste, ni avec l'extrême droite.
DE PROFONDES DIFFÉRENCES PARMI LES LIBÉRAUX
Il
est important de rappeler à ce propos que cela n'a été possible, en
tout cas dans la sphère culturelle, que grâce à l'action courageuse du
grand poète et essayiste mexicain Octavio Paz (1914-1998). Après la
chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS et la transformation de
la Chine en pays capitaliste (quoique autoritaire), les idées
politiques ont elles aussi évolué, et la culture de la liberté a fait
d'importants progrès.
Du
fait que le libéralisme n'est pas une idéologie, mais une doctrine
ouverte et évolutive qui s'incline devant la réalité au lieu de
s'entêter à faire plier la réalité, il existe diverses tendances et de
profondes différences parmi les libéraux. En ce qui concerne la religion
et les questions sociétales, les libéraux qui, comme moi, sont
agnostiques, favorables à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et
pour la décriminalisation de l'avortement, du mariage gay et des drogues
s'attirent les critiques d'autres libéraux qui ont des opinions
contraires. Ces différences de vue sont saines et utiles, car elles
n'enfreignent pas les préceptes fondamentaux du libéralisme.
Il
existe par exemple des libéraux qui pensent que l'économie est le
domaine au travers duquel tous les problèmes se résolvent, et que le
marché libre est la panacée à tous les maux, de la pauvreté au chômage,
en passant par la discrimination et l'exclusion sociale. Ces libéraux,
de véritables algorithmes vivants, ont parfois fait plus de tort à la
cause de la liberté que les marxistes, lesquels furent les premiers à
proclamer l'idée absurde que l'économie est la force motrice de
l'Histoire. Cela n'est tout simplement pas vrai. Ce sont les idées et la
culture, et non l'économie, qui distinguent la civilisation de la
barbarie.
LA LIBERTÉ, UNE VALEUR ABSOLUMENT ESSENTIELLE
L'économie
à elle seule peut produire des résultats optimaux sur le papier, mais
elle ne peut constituer un objectif à la vie. Certes le marché libre est
le meilleur mécanisme existant pour produire des richesses et,
correctement couplé à d'autres institutions et usages démocratiques, il
peut porter le progrès matériel d'un pays à des niveaux spectaculaires.
Mais c'est aussi un instrument implacable qui, sans l'élément spirituel
et intellectuel que représente la culture, risque de réduire la vie à
une lutte féroce.
Le
libéral que j'aspire à être considère donc la liberté comme une valeur
absolument essentielle. Ses fondements sont la propriété privée et
l'Etat de droit. Ce système réduit au maximum les formes possibles
d'injustice, génère mieux que tout autre le progrès matériel et
culturel, contient le plus efficacement la violence et veille au respect
des droits humains. Les libertés politique et économique présentent les
deux faces d'une même médaille.
C'est
parce que la liberté n'a pas été comprise ainsi en Amérique latine que
la région a assisté à de nombreuses tentatives ratées d'instaurer la
démocratie. Cela était dû, soit au fait que les démocraties qui ont
émergé à la suite du renversement des dictatures respectaient la liberté
politique mais rejetaient la liberté économique, ce qui a produit plus
de pauvreté, d'inefficacité et de corruption, soit parce qu'elles ont
mis en place des gouvernements autoritaires persuadés que seuls une
poigne de fer et un régime répressif pouvaient garantir le
fonctionnement du marché libre.
LE LIBÉRALISME EST TOLÉRANCE ET RESPECT DES AUTRES
Démocratie
politique, liberté de la presse et marché libre sont les fondements
d'une position libérale. Pourtant, ainsi formulées, ces trois
expressions ont un aspect abstrait qui les déshumanise. Le libéralisme
est beaucoup plus que cela. Il est tolérance et respect des autres, et
notamment de ceux qui ne pensent pas la même chose que vous, pratiquent
d'autres coutumes, adorent un autre dieu ou ne sont pas croyants.
Quand
ils ont accepté de vivre avec des gens différents d'eux-mêmes, les
hommes ont accompli un pas essentiel. Cette acceptation a précédé la
démocratie et l'a rendue possible, contribuant plus que n'importe quelle
découverte scientifique ou système philosophique à refréner la
violence. C'est aussi elle qui a éveillé cette méfiance naturelle à
l'égard du pouvoir qui, chez nous autres libéraux, est une sorte de
seconde nature. Car si l'on ne peut pas se passer du pouvoir, sauf bien
entendu dans les utopies anarchistes, il faut pouvoir le contrôler et le
contrebalancer.
Défendre
l'individu est la conséquence naturelle de la foi en la liberté en tant
que valeur individuelle et sociale par excellence, car au sein d'une
société, la liberté se mesure au degré d'autonomie dont jouissent les
citoyens pour organiser leur vie et poursuivre leurs buts sans
interférence injuste. Le collectivisme était inévitable à l'aube de
l'Histoire. Mais il a survécu dans ces doctrines et idéologies qui
situent la valeur suprême d'un individu dans son appartenance à un
groupe. Toutes ces doctrines – nazisme, fascisme, fanatisme religieux,
communisme et nationalisme – sont les ennemis naturels de la liberté.
LE PLUS GRAND OBSTACLE EST LE POPULISME
Un
grand penseur libéral, l'économiste autrichien Ludwig von Mises
(1881-1973), a toujours été opposé à l'existence de partis libéraux, car
il estimait que ces formations, en tentant de monopoliser le
libéralisme, finissent toujours par le dénaturer. Il pensait que la
philosophie libérale doit être une culture partagée par tous les
courants et mouvements politiques. Il y a beaucoup de vrai dans cette
théorie.
Ainsi,
au cours du passé récent, nous avons vu des gouvernements conservateurs
comme ceux du président américain Ronald Reagan, des premiers ministres
britannique et espagnol, Margaret Thatcher et José Maria Aznar,
procéder à des réformes profondément libérales. Mais nous avons vu aussi
des dirigeants officiellement socialistes, comme Tony Blair au
Royaume-Uni, Ricardo Lagos au Chili ou, aujourd'hui, José Mujica en
Uruguay mettre en œuvre des politiques sociales et économiques, que l'on
ne peut qualifier autrement que de libérales.
Plus
que la révolution, c'est aujourd'hui le populisme qui constitue le plus
grand obstacle au progrès en Amérique latine. Il y a bien des façons de
définir le « populisme », mais la plus précise est probablement celle
qui le tient pour un ensemble de politiques sociales et économiques
démagogiques qui sacrifient l'avenir du pays au profit d'un présent
éphémère. Avec une rhétorique enflammée, la présidente argentine,
Cristina Fernandez de Kirchner, a poursuivi dans la voie des
nationalisations, de l'interventionnisme, des contrôles, de la
persécution de la presse indépendante, toutes politiques qui ont conduit
au bord de la désintégration un pays qui, potentiellement, pourrait
être l'un des plus prospères du monde.
Mais
contrairement à une époque encore toute récente, ces pays sont
l'exception et non la règle, et l'Amérique latine se débarrasse peu à
peu, non seulement des dictatures, mais aussi des politiques économiques
qui ont longtemps maintenu ses pays dans la pauvreté.
Même
la gauche se montre aujourd'hui réticente à revenir sur la
privatisation des retraites – instaurée dans onze pays latino-américains
à ce jour – alors que la gauche nord-américaine, plus rétrograde,
s'oppose à la privatisation du système d'allocations aux personnes
âgées. Différents signes montrent que la gauche admet, sans le
reconnaître, peu à peu que la voie du progrès économique et de la
justice sociale passe par la démocratie et le marché, ce que nous autres
libéraux avons longtemps prêché dans le vide
Traduit de l'anglais par Gilles Berton
Mario Vargas Llosa
Ecrivain et essayiste, Mario Vargas Llosa est né en 1936 au Pérou. Prix Nobel de littérature 2010, il est l'auteur d'une œuvre traversée par le destin politique de l'Amérique latine. Séduit un temps par le castrisme, il rompt avec l'extrême gauche en 1971 et s'oriente vers le libéralisme. En 1990, il se porte candidat à l'élection présidentielle péruvienne. Il a récemment publié « Le Rêve du Celte » (Gallimard, 2011). Le texte ci-dessus est extrait d'une conférence prononcée le 21août lors de la Réunion des lauréats du prix Nobel à Lindau (Allemagne).
Source Le Monde 6/9/2014

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire